Sous les rochers, la plage ?
De
loin, le décor est celui de ces « vacances de rêve » des cartes
postales à ciel turquoise : un club en bord de
mer sur une plage vénézuélienne. Pourtant les vacances qu’y passe
Stéphane, un français divorcé d’une femme du pays, sorte de looser-né
plutôt attendrissant, en compagnie de son fils Pablo qu’il
ne voit que quelques semaines par an, tiennent plutôt du cauchemar ;
et ce Roman de plage de Philippe Garnier n’a de « roman de plage » que le titre.
A
l’image de ce titre volontairement trompeur et en même temps
objectivement indiscutable, l’ambiance au club ne ressemble pas à
ce à quoi on s’attendrait : la vie des vacanciers y a clairement
quelque chose de carcéral, et ce avant même que l’intrigue se noue. S’y
retrouve un monde clos, replié sur lui-même,
pathologiquement attaché à ses souvenirs et à ses privilèges
menacés, en proie à une peur paranoïaque de l’extérieur – c’est-à-dire
surtout des dérives du nouveau régime, celui de Chávez,
présenté sous ses aspects les plus noirs. A cela s’ajoutent le
traumatisant souvenir d’enfants disparus, la menace récurrente de
glissements de terrain et d’éboulements de rochers
destructeurs.
Dans
le désir inconscient d’échapper à la névrose de leurs parents, les
enfants forment au sein du club une sorte de
microsociété à eux, opaque, dont sont exclus les adultes, et dans
laquelle Stéphane observe avec envie son fils se fondre sans peine – un
fils avec lequel la conversation se limite à quelques
mots, et qu’il n’est même plus certain de reconnaître dès lors que
celui-ci est en maillot de bain et porte ses lunettes de piscine.
En
fait, ce qui est troublant, à la lecture de ce livre, c’est que les
choses ne semblent pas être ce qu’elles devraient être.
On vit dans une atmosphère de cauchemar, d’incompréhension parfois
comique – on pense parfois à Kafka, et on se souvient alors que Philippe
Garnier était déjà l’auteur d’un petit livre étrange et
fort, Mon père s’est perdu au fond du couloir,
paru chez Melville en 2005 – et en même temps tout cela s’inscrit dans
un
cadre historique et géographique clairement défini, et l’on est bien
obligé de reconnaître que les événements racontés sont
« objectivement » tout à fait plausibles. De l’art discret de
transformer un roman réaliste, à la narration classique, en tout
autre chose.
Mars 2008.
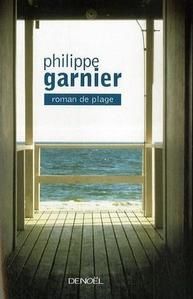
Roman de plage est paru en 2007 aux éditions Denoël. Philippe Garnier est aussi l’auteur du tout récent
Babel nuit, qui vient de paraître chez Verticales.










Et maintenant il s'est concentré dans la pure littérature comme il y a du whisky pur malt, à cacher dans un sac en papier (la bouteille ou les pages), genre kraft ou plus simplement tout blanc.