On
a travaillé beaucoup. On n’en avait pas toujours conscience parce que
travailler c’était écrire, c’était lire, et si on a
connu pas mal de déceptions on y a pris aussi tant de plaisir qu’on
oubliait que c’était du travail. Pour espérer peut-être enfin savoir un
peu écrire, un peu lire aussi.
Travail après tout n’est peut-être pas le meilleur mot mais on y a consacré du temps et de l’énergie.
Et puis, arrivé là, on était en fait juste sur le seuil. Il fallait accomplir tout un autre travail encore, et là peut-être
encore travail n’est peut-être pas le meilleur mot mais pas
le pire non plus car il demandait peut-être encore plus de temps et
d’énergie : il fallait oublier sans oublier.
Désapprendre en connaissance de cause. Renoncer à la facilité
acquise au prix de la pratique quotidienne. Renier ses modèles. Voir
s’il n’y avait pas quelque chose qu’on n’ait pas vu encore.
Faire mentir ceux qui il y a trois siècles, il y a deux millénaires
disaient que tout avait été dit déjà. (Et leur donner raison aussi : car
c’était bien afin que deux mille ans, trois cents
ans plus tard on tente encore sa chance qu’ils avaient osé une telle
profération).
La
création n’était pas immédiatement reconnaissable. Il y avait là bien
sûr matière à frustration : l’ego pour sa part
tenait à la reconnaissance. Mais il fallait bien admettre que
c’était naturel : on ne pouvait pas espérer que des gens reconnaissent
ce qu’ils ne connaissaient pas. On pouvait juste espérer
qu’ils fassent connaissance avec. Parfois, on avait l’impression que
cela arrivait. Ça faisait plaisir. D’autres fois on se rendait compte
que la création n’était qu’une illusion : il n’y
avait rien sur la table où on croyait l’avoir laissée. Pour soi-même
non plus, la création n’était pas immédiatement reconnaissable.
Quand
tout allait bien, la solution de simplicité aurait consisté à exploiter
le filon découvert. La plupart des confrères ne
s’en privaient pas, et cela semblait plutôt leur réussir. Mais on
n’était pas trop sûr non plus que c’était cela, la réussite. On avait à
peu près réussi à se défaire de l’essentiel des
influences, si impérieuses autrefois, ce n’était pas pour devenir le
singe de soi-même.
Il fallait encore, il faudrait à chaque fois se défaire de soi – pour avoir peut-être une chance de l’être enfin, juste un
instant.





 Quelques vrais articles sur
Quelques vrais articles sur 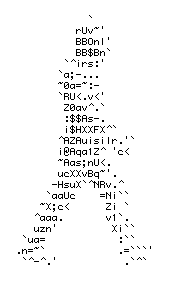
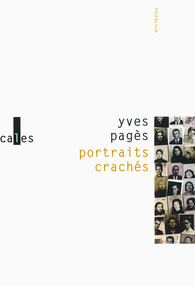

J'avais lu le précédent, de Marc Villemain, "Et que morts s'ensuivent".
Il faut beaucoup, beaucoup de temps avant de pouvoir s'en relever pour continuer.
Au-dela du talent.