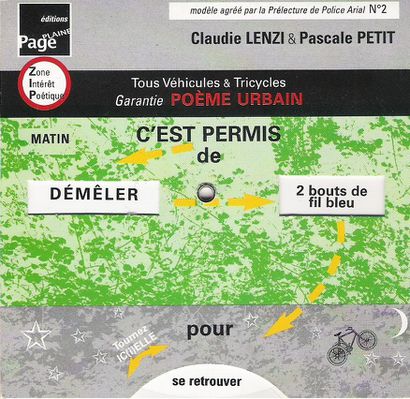J’ai lu la deuxième vie d’Aurélien Moreau, de Tatiana
Arfel. Ça vaut le coup (sinon je n’en parlerais pas ici,
vous aviez compris). Il y a bien quelques passages qui m’ont moins
convaincu, mais dans l’ensemble, c’est vraiment bien. A quoi
tiennent ces petites réserves ? Sans doute à un thème qui m’est trop
cher, pensez : le sentiment de sa propre inexistence. Une vie entière
où l’être ne fait que tendre à se conformer à
ce qu’on attend de lui (une vie qui ne sera donc – car Tatiana Arfel
est plus optimiste que moi – que la première vie d’Aurélien Moreau). Il
s’agit dans un premier temps de cerner cette
personnalité qui s’esquive, refuse d’en être une, au point de
développer une authentique pathologie : Aurélien Moreau est normopathe.
J’aime beaucoup le premier biais choisi par
l’auteur : le regard des autres – car il n’y a guère que par là
qu’on a l’assurance d’exister. Et c’est l’occasion pour Tatiana Arfel de
se livrer à un exercice assez jubilatoire pour le
lecteur. Divers personnages de l’entourage du protagoniste
(essentiellement de la famille et de la vie professionnelle) sont
convoqués et invités à dire ce qu’ils pensent d’Aurélien Moreau, sans
qu’on connaisse à ce moment les raisons de cet interrogatoire
(qu’évidemment je ne vous donnerai pas). Leur parole nous est livrée
brute, nous n’entendons pas les questions ; en revanche ce
qu’on entend vraiment, ce sont toutes ces parlures diverses et entre
elles dissonantes. C’est très réussi, et souvent drôle aussi.
Puis
ce sont les carnets que tient l’Aurélien de la première vie qui nous
sont donnés à lire, comme en son absence – puisqu’à ce
moment de son histoire Aurélien est comme absent à lui-même. Alors
là c’est peut-être ce que j’ai préféré et j’en aurais bien redemandé.
Jugez plutôt :
Lundi 6, saint Nicolas
Nicolas personnellement connu : Saint-, ami de ma mère, lui faisait passer des bonbons pour moi.
Correspondance années passées : plus de bonbons depuis Victoire.
Météo : blanche et venteuse.
Travail : non. Non. Non. Ce n’est pas pour moi. Ne me concerne pas.
Autres actions effectuées : caché tiroir avec les autres. Pourquoi ?
Dicton : non, je n’ai pas à me rendre compte. Ni à vous, qui que soit vous.
Prévision pour demain : usine. Pas de risque.
(…)
Jeudi 9, saint Pierre Fourier
Pierre Fourier personnellement connu : incertitude, cf. supra..
Travail : envoyé courriers, courriers, courriers.
Autres actions effectuées : je signe mes courriers. Car. J’ai. Un. Nom.
Voilà, c’est aux pages 61-62, mais pour bien faire il aurait fallu que j’en recopie davantage.
Il
y a dans cette façon de raconter – car ceci est bien du récit, il se
passe même des choses essentielles pour l’intrigue
derrière les mots normés (de moins en moins) d’Aurélien Moreau – une
belle expression de la négation du temps qui passe, mais qui passe
quand même et devra être rattrapé : j’aurais dû
préciser que notre héros est quadragénaire, père d’une famille déjà
oubliée et directeur dans la société présidée par son beau-père et
spécialisée dans les… simulateurs de vie pour la protection
de l’intérieur.
La crise monte, ses carnets formatés ne lui suffisent plus et jusqu’à l’événement qui déclenchera la deuxième vie d’Aurélien
Moreau (laquelle finalement ne représente que le dernier tiers
du roman), le récit prend la forme plus banale d’un journal à la
première personne et c’est là que j’ai ressenti quand même un
peu d’ennui ou en tout cas de déception tant le début m’avait
emballé. Le personnage s’y dévoilant peut-être un peu trop n’est déjà
plus le normopathe inatteignable qu’il a toujours été, c’était
peut-être une nécessité du récit mais le fait est que celui-ci perd à
mes yeux de sa densité et en tout cas de sa singularité, il m’a même
semblé parfois qu’on n’était pas très loin du
cliché.
Heureusement il y a donc encore dans cette deuxième vie d’Aurélien Moreau
une deuxième vie d’Aurélien Moreau, et là les
choses reprennent chair et voix notamment grâce à la langue ; car ce
nouvel Aurélien qui n’est plus tout à fait l’ancien souffre (et
bénéficie) désormais d’une discrète pathologie langagière
qui accompagne sa renaissance. Celle-ci passe par la découverte de
ce qui fait la vie : plaisirs des sens jusque là occultés notamment à
l’occasion des voyages qu’il avait auparavant
toujours évités : Bretagne, Grèce, Toscane. Bien sûr il y aura là de
la carte postale idyllique mais le cliché sur elle représenté est
assumé : Aurélien découvre ce que,
souhaitons-le-nous, nous connaissons déjà ; rien d’étonnant alors à
ce que ces couleurs nouvelles pour lui en pleine quarantaine nous
paraissent presque un peu trop vives, d’autant plus
qu’Aurélien entre enfin en communion, n’ayons pas peur des mots,
avec autrui, dans les plaisirs partagés de cette vie nouvelle : le
lecteur avec lui se rappelle ses propres vacances, et
c’est quand même vrai qu’elles étaient bonnes, rappelle-toi,
efkaristopoli. Du coup j’en reprendrais bien, et pourquoi pas aussi un
peu de Tatiana Arfel, tiens, car je vois que c’est son
troisième roman, il y en aura forcément d’autres et sûrement de
beaux.
La deuxième vie d’Aurélien
Moreau vient de paraître aux éditions Corti, qui méritent toujours d’être redécouvertes.
Commentaires
Et bien malgré les réserves ça me donne envie de le lire!
Commentaire n°1
posté par
sissi
le 21/11/2013 à 15h58
Mais c'est vraiment un livre à lire en effet.
Réponse de
PhA
le 21/11/2013 à 17h42