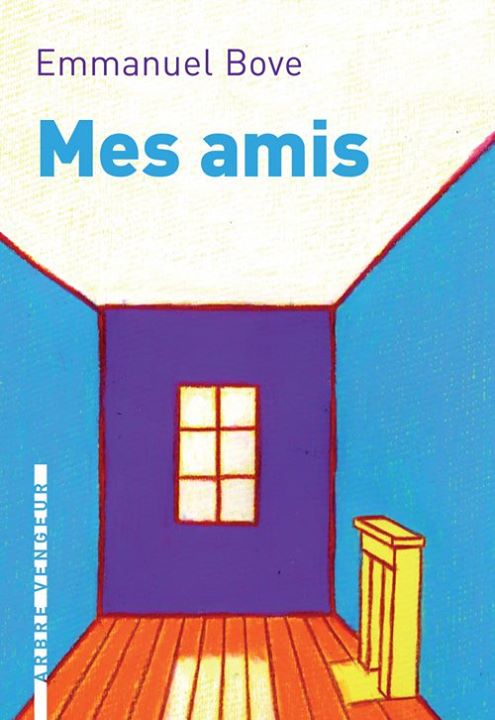Je n’ai pas pu m’en empêcher, je
suis allé au bureau, à mon habitude je me suis profondément incliné devant M.
Benjamenta, et je lui ai parlé de la façon suivante : « J’ai des
bras, des jambes et des mains, monsieur Benjamenta, et je voudrais travailler,
c’est pourquoi je me permets de vous prier de me procurer le plus tôt possible
une place et un salaire. Vous avez toutes sortes de relations, je le sais. Vous
recevez les patrons les plus distingués, des gens qui portent une couronne au
revers de leur manteau, des officiers traîneurs de sabres tranchants, des dames
dont la traîne s’approche avec un bruissement de vagues ricanantes, des femmes
d’un certain âge pourvues d’une fortune énorme, des vieillards qui paient un
demi-sourire d’un million, des gens de qualité, mais sans esprit, des gens qui
roulent en automobile, en un mot, monsieur le Directeur, le monde vient chez
vous. » – « Prends garde à ne pas devenir insolentes, me dit-il pour
m’avertir, mais je ne sais pourquoi, je n’avais plus du tout peur de ses
poings, et je continuai, les mots me sortant tout seuls de la bouche : « Procurez-moi
à tout prix une quelconque activité qui me stimule. D’ailleurs mon opinion est
la suivante : n’importe quelle activité stimule. J’ai déjà tant appris
chez vous, monsieur le Directeur. » – Il dit tranquillement : « Tu
n’as encore rien appris du tout. » Mais je repris le fil et continuai :
« Dieu lui-même m’a ordonné de me lancer dans la vie. Mais qui est Dieu ?
Vous êtes mon Dieu, monsieur le Directeur, si vous me permettez d’aller gagner
argent et considération. » Il se tut un instant, puis il dit : « Tâche
maintenant de déguerpir. Sur-le-champ. » Cela m'irrita terriblement. Je m’écriai
en haussant la voix : « Je vois en vous un homme remarquable, mais je
me trompe, vous êtes aussi banal que l’époque dans laquelle vous vivez. Je vais
descendre dans la rue et j’attaquerai le premier venu. On me force à devenir
criminel. » – Je reconnus le danger suspendu sur ma tête. Dans le même
temps que je prononçais les derniers mots, j’avais bondi à la porte et là, je
criai sur un ton rageur : « Adieu, monsieur le Directeur », puis
je me glissai dehors avec une souplesse merveilleuse. Je m’arrêtai dans le
corridor et collai l’oreille au trou de la serrure. Pas le plus petit bruit dans
le bureau. J’allai dans la salle de classe et me plongeai dans la lecture du livre
Quel est le but de l’école de garçons Benjamenta ?
Robert Walser, l’Institut
Benjamenta, traduit par Marthe Robert.